Cinq raisons pour lesquelles le VIH/SIDA existe depuis un siècle
- May 24, 2021
- HIV/AIDS
- By Armelle Nyobe
- Read in English
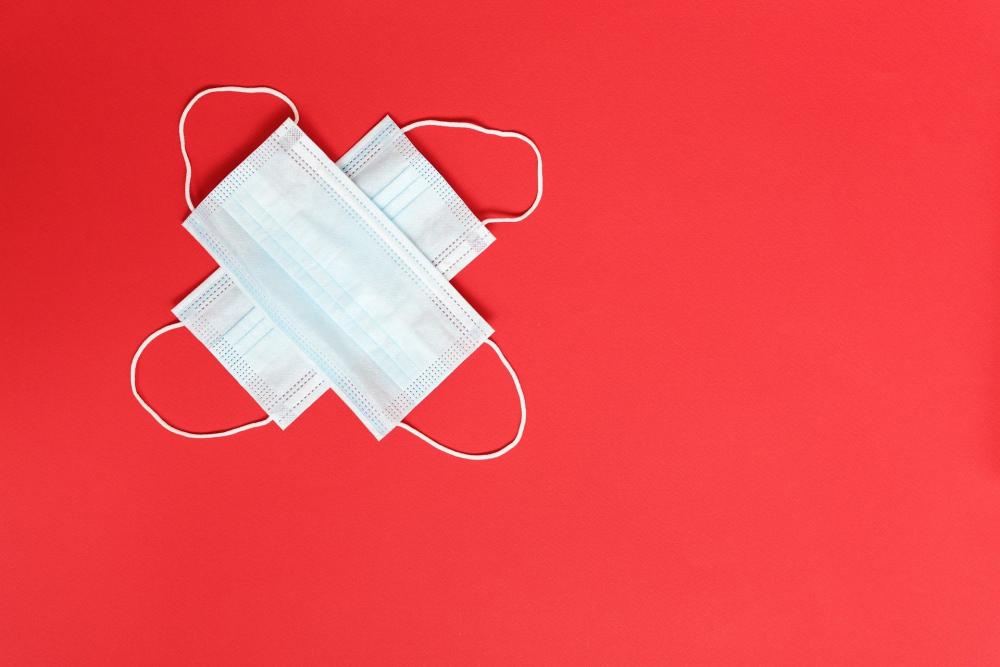
L’omniprésence silencieuse de la dystopie
Les années 1960 correspondent à l’ère des discothèques, des pantalons à pattes d’éléphant, des cheveux en bataille et des chemises à demi-boutonnées. Les mouvements anticulturels ont pris de l’ampleur et l’individualisme est devenu un concept populaire, tandis que les médias gagnaient en confiance et en influence et vantaient les mérites d’une nouvelle ère moderne. Des bouleversements et de l’agitation se sont également produits aux quatre coins du monde. L’Occident croule sous les effets traumatisants des guerres, les systèmes politiques de tous les continents changent et craquent sur des rouages instables, et les dirigeants africains affrontent les colonialistes tandis que la jeune population du continent réclame le changement. Selon le Centre des Etudes Africaines, 1960 a été “l’année de l’Afrique”, avec 17 colonies devenues politiquement indépendantes.
Au cœur de ces nombreuses réformes radicales, le VIH/sida s’est silencieusement infiltré, son signe avant-coureur ayant pris forme des décennies plus tôt, en 1920, à la suite du passage du virus de l’immunodéficience simienne (VIS) du chimpanzé à l’homme à Kinshasa, au Congo. Cette première incapacité à diagnostiquer, contenir et éradiquer rapidement la maladie fait écho à celle de nombreuses autres pandémies.
L’exploitation financière des pandémies
La trajectoire d’une maladie commence souvent de manière lente avant de prendre de l’ampleur. Or, c’est à ses débuts que se situent les plus grandes chances de l’éradiquer. Ce constat s’inscrit uniquement dans une perspective humaniste. Si l’on y ajoute l’insipide réalité selon laquelle le chaos peut être un outil pour imposer des réformes sociales, exploiter les marchés économiques et exercer un certain pouvoir de domination, il devient évident que les pandémies qui suivent leur cours de manière incontrôlée représentent à la fois le brasier qui détruit et celui qui déblaie le terrain pour favoriser l’exploitation.
Dans son document 2020 intitulé ” Power, Profits and the Pandemic ” (pouvoir, profits et pandémie), Oxfam a présenté des faits poignants sur la dernière pandémie mondiale, la COVID-19. L’organisation à but non lucratif a déclaré : “Quatre cent millions d’emplois ont été éliminés au cours de cette pandémie, mais on estime que 32 des entreprises les plus lucratives du monde gagneront 109 milliards de dollars de plus en 2020 qu’au cours des années précédentes. Ces mêmes 32 sociétés super-prospères ont distribué 1,3 trillion de dollars à leurs actionnaires les plus riches au cours des quatre années qui ont précédé la pandémie de COVID-19. Depuis janvier, elles ont déjà versé 195 milliards de dollars aux actionnaires.”
Ces faits sont aussi choquants que douloureux. Dans quelle mesure les pandémies sont-elles lucratives ? Selon le Lancet Journal, en 2006, le Fonds mondial présentait un déficit de financement de 2,1 milliards de dollars, soit la moitié des fonds nécessaires pour continuer à accorder des subventions dans la lutte contre le VIH/sida. L’éditorial du journal du mois d’août de cette année-là s’intitulait “The Business of HIV/AIDS” (Les affaires du VIH/sida) et rendait compte de manière courageuse des efforts déployés par de nombreuses entreprises pour aider à collecter des fonds pour des organismes tels que le Fonds mondial. Dix millions de dollars avaient été collectés en quatre mois ; un chiffre impressionnant pour un profane, de la menue monnaie pour un groupe d’entreprises mondiales.
La trajectoire perpétuelle de la stigmatisation
Dans les années 1980, le VIH/SIDA n’était plus une simple rumeur. Son existence était un fait avéré et la majorité des mythes qui l’entouraient étaient démystifiés. Même à cette époque, et en dépit de l’éducation dispensée par les scientifiques et les personnalités publiques, le VIH/SIDA a continué à être caricaturé comme une maladie monstrueuse. Ceux qui en étaient atteints étaient marginalisés et diabolisés. Ceux qui ne l’avaient pas vivaient dans la peur constante de l’attraper. Ce fut le deuxième échec. Le discours de la société sur le VIH/SIDA était aussi fort que le silence imposé à ses victimes. Car c’est ce qu’elles étaient à cette époque : des victimes. Nous savons désormais qu’il ne faut pas qualifier de victime toute personne atteinte du VIH/sida. Mais la question qui se pose est la suivante : que fait la stigmatisation continuelle, si ce n’est victimiser?
Des millions de personnes dans le monde ont ressenti, été affectées et ont vu leur vie changer de manière irréversible du fait du VIH/sida. Bien que les images obsédantes de patients aux joues creuses, squelettiques, aux cheveux clairsemés et aux yeux terrifiés aient largement cessé d’être diffusées par les médias et vues par le public, nous nous en souvenons encore parce que nous avons vécu avec ces images. Il s’agissait de nos parents, cousins, tantes, oncles, amis. La tristesse et le chagrin sont toujours présents, exacerbés par notre propre séropositivité ou celle des membres de notre famille et de nos pairs. Et aujourd’hui, dans de nombreux foyers, hôpitaux et hospices d’Afrique, le VIH/sida est toujours aussi accablant qu’il l’était il y a plusieurs décennies, et la stigmatisation est toujours aussi forte.
Accès au TARV, politique des brevets et dialogue tronqué
La thérapie antirétrovirale (TARV) est la réponse la plus efficace au VIH/SIDA dans le monde, mais elle s’accompagne de ses propres politiques et rapports de force, souvent au détriment des personnes bénéficiaires. Tout au long des années 2000, les sociétés pharmaceutiques ont été mêlées à un ou plusieurs scandales. La guerre des brevets, les anomalies dans la fixation des prix et les attentes des actionnaires en matière de profits ne sont que quelques exemples de la manière dont le mercantilisme continue d’influencer ce qui devrait être une approche humaniste de la pandémie. Le géant biopharmaceutique Gilead Sciences fait actuellement l’objet de multiples actions en justice pour avoir décidé en 2004 d’interrompre le lancement d’un nouveau médicament amélioré contre le VIH/sida, le TAF, afin de pouvoir continuer à tirer profit du tenofovirthat, moins efficace mais déjà mis sur le marché.
En Afrique subsaharienne, la région la plus touchée au monde, la priorité absolue est de maintenir les patients en bonne santé et en vie par tous les moyens possibles. Soucieuse de se procurer gratuitement ou à bas prix les médicaments qui permettent de prolonger la vie des patients, l’Afrique a du mal à se lancer dans des discussions plus audacieuses sur la commercialisation de la pandémie. Etant le continent le plus pauvre du monde, la participation de l’Afrique dans toute tribune de discussions est souvent limitée.
Il faut toutefois reconnaître que des progrès ont été accomplis. Lorsqu’il est utilisé de manière correcte et accompagné d’une alimentation et d’un mode de vie sains, le traitement antirétroviral dépossède le VIH/sida de son pouvoir autrefois si redoutable. Des millions de personnes séropositives ont désormais une charge virale tellement faible qu’elle est indétectable. Il s’agit là d’un véritable succès, mais ce terme reste relatif. Le VIH/sida existe depuis 100 ans et a constitué une crise de santé publique pendant 40 ans. Pour un monde axé sur la technologie et l’intelligence, c’est une période trop longue pour lutter contre une seule maladie.
Notre démarche monotone
Les taux de transmission au quotidien sont alimentés par une multitude de facteurs : La pauvreté, l’analphabétisme, les problèmes de santé mentale, les abus, les luttes de pouvoir, les normes culturelles, tous ces facteurs étant sous tendus par l’inégalité des catégories sociales, la honte, la peur et le silence. Le secret doit être dévoilé. Les cadavres doivent sortir des placards. Il est nécessaire de tenir des discussions sensibles. Nous nous rétablissons et gérons mieux nos vies lorsque nous parlons enfin des situations que nous avons gardées cachées et que nous y faisons face.
Nous avons été instruits sur les OMD et les ODD. OMD 6 : Lutter contre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies. ODD 3 : Bonne santé et bien-être. Ce sont des textes que nous avons mémorisés et chaque année, des symposiums, des conférences, des entretiens, des ateliers et des assemblées générales annuelles sont organisés pour discuter du bilan des progrès accomplis par le monde dans la réalisation des objectifs fixés. Et chaque année, on constate que le niveau d’avancement reste insuffisant ; il existe des lacunes et des défis qui font encore obstacle à la réalisation des objectifs. Des rapports, des documents et des articles sont échangés, reproduisant chacun de manière monotone les présentations de l’année précédente et de l’année d’avant.
Les conversations franches n’ont pas lieu. Pourquoi cette maladie existe-t-elle depuis aussi longtemps ? Les dirigeants et décideurs mondiaux traitent-ils le VIH/sida comme un brasier qui détruit ou comme un feu qui déblaie le terrain pour l’exploitation ? Les dirigeants locaux sortent-ils de leur zone de confort et redéfinissent-ils une nouvelle approche du fléau ? Nos programmes de sensibilisation et nos campagnes médiatiques sont-ils dépassés et monotones ?
Il est facile de présenter des statistiques, de dresser un portrait effroyable des taux d’infection par le VIH/sida, des taux de mortalité et de l’étendue de son impact. Mais l’horreur, nous le savons, a tendance à perdre son effet de choc. Le monde a changé et ses habitants, essentiellement des jeunes, ne sont pas plus émus par les statistiques qu’ils ne sont terrifiés par le carnage qui s’affiche sur l’écran de leur ordinateur ou de leur téléphone portable. Le succès ou l’échec du ralliement de cette génération à la cause de l’élimination de la propagation du VIH/sida dépend en grande partie du type de conversations tenues dans les salles de conseil d’administration, les conférences, les salons, les chambres à coucher, les laboratoires, les suites présidentielles, les sommets mondiaux, les salles de classe et les amphithéâtres. Il n’existe pas de lieu ou de plateforme trop petit ou trop grand pour ne pas être en mesure de faciliter l’initiation de conversations qui nous rappellent tous notre humanité, ceux que nous avons perdus et ceux que nous ne devons pas perdre. Il est temps de réécrire l’histoire d’un siècle.
Alice M. Simushi


